
Arbitrer l’avenir : repenser le règlement des différends internationaux à l’ère des bouleversements stratégiques – perspective 2035
Par : Daniel Peña Valenzuela
Introduction
D’ici 2035, l’arbitrage international sera redéfini non seulement par l’innovation juridique, mais aussi par sa pertinence stratégique dans un monde marqué par la fragmentation géopolitique, l’accélération technologique et la transition écologique. L’arbitrage n’est plus un mécanisme périphérique pour les litiges commerciaux, il devient une arène centrale où les États, les entreprises et les acteurs transnationaux négocient le pouvoir, la légitimité et le risque. À mesure que la gouvernance mondiale devient plus contestée et multipolaire, l’arbitrage doit évoluer pour traiter des litiges complexes qui reflètent les priorités stratégiques d’un monde en rapide transformation.
Les études prospectives ne se contentent pas de prévoir l’avenir, elles examinent de manière critique le présent afin de comprendre comment les valeurs, les systèmes et les décisions actuels façonnent les futurs possibles. En analysant les hypothèses et les structures de pouvoir actuelles, ce domaine révèle comment l’avenir se construit déjà dans le présent.
Ses outils, tels que la planification de scénarios et le backcasting, s’appuient sur les tendances et les bouleversements actuels pour imaginer des alternatives. Cela fait des études prospectives un outil stratégique pour repenser les défis d’aujourd’hui, permettant de prendre des décisions plus inclusives et anticipatives, fondées sur les réalités actuelles.
L’évolution de l’arbitrage international ne peut être comprise uniquement à travers le prisme du développement juridique. Bien qu’il partage des similitudes structurelles avec d’autres institutions juridiques, telles que la codification, le raffinement des procédures et l’émergence d’organismes spécialisés, sa trajectoire a été façonnée de manière unique par les exigences du commerce transfrontalier et la nécessité de mécanismes neutres de résolution des litiges. L’arbitrage est apparu comme une réponse pragmatique aux limites des tribunaux nationaux dans le traitement des conflits transnationaux, en particulier dans les contextes où la souveraineté, la compétence et l’applicabilité posaient des défis importants.
Les conditions politiques et économiques ont joué un rôle décisif dans l’élaboration de l’architecture institutionnelle de l’arbitrage. De l’essor des traités bilatéraux d’investissement (TBI) à la prolifération des accords de libre-échange, les États ont de plus en plus adopté l’arbitrage comme un outil pour attirer les investissements étrangers et atténuer les risques géopolitiques. L’expansion des marchés mondiaux après la guerre froide, associée à la libéralisation des régimes commerciaux, a créé un terrain fertile pour l’essor de l’arbitrage. Des institutions telles que le CIRDI et la CNUDCI ont gagné en importance non seulement en raison de leur sophistication juridique, mais aussi parce qu’elles offraient prévisibilité et légitimité dans des environnements politiquement sensibles.
L’évolution des pratiques commerciales et des stratégies d’entreprise a été tout aussi importante. À mesure que les entreprises multinationales étendaient leurs activités à travers les juridictions, le besoin de mécanismes de résolution des litiges efficaces, confidentiels et exécutoires est devenu primordial. L’arbitrage s’est adapté à ces besoins en offrant une flexibilité procédurale, l’autonomie des parties et l’applicabilité en vertu d’instruments tels que la Convention de New York. Aujourd’hui, l’arbitrage reflète une interaction dynamique entre les normes juridiques, le pragmatisme commercial et les considérations géopolitiques, ce qui en fait non seulement une institution juridique, mais aussi un instrument stratégique de gouvernance mondiale.
Pressions stratégiques et nouveaux fronts de litiges
L’idée d’une « crise » de l’arbitrage découle souvent de préoccupations liées à la légitimité, à la transparence, au coût et à la cohérence, en particulier dans le cadre du règlement des différends entre investisseurs et États (ISDS). Les détracteurs affirment que l’arbitrage est devenu trop légaliste, coûteux et déconnecté des besoins des communautés concernées ou des intérêts publics. Certains soulignent la réaction négative des États qui révisent ou se retirent des traités, ou encore la fragmentation procédurale et l’imprévisibilité des résultats arbitraux.
Pourtant, ces tensions mêmes pourraient être le signe d’une renaissance plutôt que d’un déclin. L’arbitrage évolue, adoptant des réformes telles qu’une plus grande transparence, la diversité dans la nomination des arbitres et des innovations procédurales. Comme le soutiennent certains chercheurs, les crises peuvent catalyser la transformation : elles poussent les institutions à s’adapter, à se perfectionner et à légitimer à nouveau leurs rôles. L’essor des tribunaux spécialisés, les nouveaux codes de conduite et l’engagement plus large des parties prenantes suggèrent que l’arbitrage n’est pas en train de s’effondrer, mais qu’il se recalibre pour un avenir plus réactif et plus résilient.
Multipolarité et essor de l’arbitrage stratégique
L’érosion du consensus juridique unipolaire cède la place à un paysage arbitral multipolaire. Les centres d’arbitrage régionaux gagnent en importance, non seulement en tant qu’alternatives aux institutions traditionnelles, mais aussi en tant que plateformes stratégiques alignées sur les intérêts nationaux et régionaux. Cette évolution reflète un rééquilibrage plus large de l’autorité juridique, où les forums d’arbitrage sont choisis non seulement pour leur neutralité, mais aussi pour leur capacité à refléter les alignements géopolitiques et les préférences réglementaires.
Le paysage international du règlement des litiges a connu une expansion remarquable, marquée par la prolifération de centres et de forums spécialisés dans différentes juridictions. Des institutions telles que le Centre d’arbitrage international de Singapour (SIAC) https://siac.org.sg/ , le Centre d’arbitrage international de Mumbai (MCIA) https://mcia.org.in/ et le Centre international d’arbitrage et de médiation d’Hyderabad https://iamch.org.in/ ont rapidement gagné en importance, traitant des milliards de dollars de litiges transfrontaliers et reflétant une demande croissante de mécanismes ancrés au niveau régional et crédibles au niveau mondial. Ces centres offrent non seulement l’arbitrage, mais aussi la médiation et des modèles hybrides, répondant ainsi au besoin de processus flexibles, efficaces et adaptés à la culture.
Parallèlement, l’essor des tribunaux commerciaux internationaux (CCI) dans des juridictions telles que Dubaï, Abu Dhabi, Singapour et l’Europe post-Brexit marque un changement stratégique. Ces tribunaux combinent les procédures de common law avec des capacités multilingues et une expertise judiciaire internationale, se positionnant comme des alternatives compétitives à l’arbitrage traditionnel. Leur émergence reflète des motivations géopolitiques et économiques plus larges : les États cherchent à projeter leur soft power, à attirer les investissements étrangers et à s’imposer comme des pôles juridiques dans l’économie mondiale.
Cette diversification des forums n’est pas seulement institutionnelle, elle est conceptuelle. La croissance des plateformes numériques de règlement extrajudiciaire des litiges, des outils de résolution assistés par l’IA et des procédures hybrides a redéfini l’accès et la participation au règlement des litiges à l’échelle mondiale. À mesure que les systèmes juridiques s’adaptent aux changements technologiques et à la complexité transnationale, l’expansion des centres et des forums ne représente pas une fragmentation, mais une innovation. Elle marque une renaissance du règlement des litiges, qui est plus pluriel, plus réactif et plus stratégiquement aligné sur l’évolution du commerce et de la gouvernance internationaux.
Dans ce contexte, l’arbitrage devient un outil de positionnement stratégique. Les États et les entreprises s’engagent de plus en plus dans le choix des forums et la conception des procédures dans le cadre de calculs géopolitiques plus larges. L’essor des traités régionaux et des cadres d’investissement, souvent assortis de mécanismes de règlement des différends, renforce encore le rôle de l’arbitrage en tant que lieu de pluralisme juridique et de contestation stratégique.
Litiges liés au climat, à l’énergie et aux ressources
La transition énergétique mondiale génère une nouvelle vague de litiges centrés sur la réglementation climatique, les obligations environnementales et l’accès aux minéraux essentiels. L’arbitrage jouera un rôle central dans le règlement des conflits liés aux infrastructures vertes, aux marchés du carbone et à la reconfiguration des systèmes énergétiques. Ces litiges ne sont pas uniquement commerciaux : ils impliquent des questions de souveraineté, de justice écologique et de contrôle stratégique des ressources.
À mesure que les États révisent leurs cadres réglementaires pour atteindre leurs objectifs climatiques, les investisseurs peuvent contester les mesures qui affectent la rentabilité ou la valorisation des actifs. L’arbitrage devra concilier la protection des investisseurs avec l’évolution des normes environnementales, en équilibrant les obligations découlant des traités avec les impératifs planétaires. L’importance stratégique de minéraux tels que le lithium, le cobalt et les terres rares intensifiera encore les litiges relatifs aux droits d’extraction, aux régimes d’octroi de licences et aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement.
La protection de l’environnement et la transition énergétique mondiale sont de plus en plus étroitement liées en tant que questions émergentes d’arbitrabilité, redéfinissant les contours de l’arbitrage commercial et de l’arbitrage en matière d’investissement. À mesure que les États adoptent des politiques climatiques, telles que l’élimination progressive des combustibles fossiles, la réglementation des émissions ou la promotion des énergies renouvelables, les investisseurs ont commencé à contester ces mesures en vertu de traités bilatéraux et multilatéraux. Des litiges concernant la tarification du carbone, les tarifs de rachat et les modifications rétroactives des incitations en faveur des énergies vertes ont déjà fait surface, révélant à quel point la réglementation environnementale et les politiques de transition énergétique ont une incidence directe sur les attentes contractuelles et celles fondées sur les traités.
Cette convergence a également conduit à l’apparition de clauses environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans les contrats, qui intègrent des obligations de durabilité dans les relations commerciales. Ces clauses sont actuellement testées dans des instances d’arbitrage, soulevant des questions procédurales et substantielles concernant leur applicabilité, la compétence juridictionnelle et les considérations d’intérêt public. L’arbitrage évolue donc pour s’adapter à des demandes complexes impliquant des risques climatiques, des changements réglementaires et des dommages environnementaux, ce qui oblige les tribunaux à trouver un équilibre entre la protection des investisseurs et les droits souverains de réglementer en faveur de la durabilité. Loin d’être périphériques, les questions environnementales et de transition énergétique deviennent centrales pour l’avenir même de l’arbitrabilité.
Technologie, innovation à double usage et sensibilités stratégiques
L’innovation technologique, en particulier dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la biotechnologie et des systèmes à double usage, redessine les contours du règlement des différends transnationaux. Les contrats impliquant des technologies sensibles recoupent de plus en plus les questions de sécurité nationale, de gouvernance des données et de réglementation éthique. L’arbitrage doit s’adapter pour traiter les litiges impliquant des algorithmes propriétaires, la biologie synthétique et les systèmes autonomes, souvent dans des contextes où la confidentialité et le contrôle stratégique sont primordiaux.
Ces litiges nécessitent des garanties procédurales spécialisées, une expertise technique et une sensibilité normative. L’arbitrage devra élaborer des protocoles pour gérer les informations classifiées, protéger la propriété intellectuelle et statuer sur les demandes qui impliquent à la fois des intérêts commerciaux et des impératifs stratégiques. La convergence des risques technologiques et géopolitiques fera de l’arbitrage un forum essentiel pour naviguer entre les frontières de l’innovation et de la réglementation.
D’ici 2035, l’intelligence artificielle sera devenue une composante structurelle de l’arbitrage international. Les systèmes d’IA aideront au triage des affaires, à l’analyse juridictionnelle et à la prédiction des résultats sur la base des précédents et des profils des tribunaux. Cette intégration accélérera les procédures, réduira les coûts et améliorera la cohérence des arguments. Cependant, elle soulèvera également des défis éthiques liés à la transparence, à l’autonomie des parties et à la surveillance algorithmique. Les institutions arbitrales auront développé des cadres normatifs pour garantir que l’intervention technologique respecte les principes fondamentaux d’une procédure régulière.
Les technologies décentralisées telles que la blockchain auront transformé la gestion des preuves et l’exécution des sentences. Les contrats intelligents comprendront des clauses d’arbitrage auto-exécutables qui déclencheront des procédures automatisées en cas de violation. Les preuves numériques seront stockées dans des chaînes de conservation vérifiables, garantissant leur intégrité et leur traçabilité. Les sentences arbitrales seront codées pour être immédiatement reconnues en vertu des conventions internationales, ce qui facilitera leur exécution sans friction juridictionnelle. Cette infrastructure consolidera l’arbitrage en tant que mécanisme fiable dans des environnements marqués par une volatilité réglementaire.
L’informatique quantique et les systèmes de traduction neuronale multilingues auront élargi la portée et la sophistication de l’arbitrage. Les algorithmes quantiques simuleront des conflits normatifs complexes et anticiperont les scénarios réglementaires dans les litiges liés à l’investissement, à la technologie et à l’environnement. Parallèlement, la traduction automatique de haute précision garantira la pleine participation des parties linguistiquement diverses sans sacrifier les nuances juridiques. Ces technologies redéfiniront le rôle des arbitres, qui non seulement interpréteront les normes, mais serviront également de médiateurs entre des paradigmes réglementaires divergents. L’arbitrage deviendra un instrument stratégique pour la coopération mondiale et la gouvernance juridique en période de perturbation.
Innovation institutionnelle et recalibrage normatif
Reconfigurer la légitimité et la participation
La légitimité de l’arbitrage à l’horizon 2030 dépendra de sa capacité à intégrer les perspectives plus larges des parties prenantes et à répondre aux préoccupations d’intérêt public. Les litiges impliquant des dommages environnementaux, les droits des populations autochtones et l’impact social nécessiteront des mécanismes qui vont au-delà de l’autonomie traditionnelle des parties. Les institutions doivent élargir l’inclusivité procédurale grâce à des outils tels que les interventions de tiers, les audiences publiques et la représentation communautaire.
Cette évolution reflète un changement stratégique, l’arbitrage passant d’un recours privé à un forum quasi public. Les litiges touchant de plus en plus aux biens communs mondiaux et aux biens collectifs, la légitimité des décisions arbitrales dépendra de la transparence, de la responsabilité et de la cohérence normative. Les institutions doivent concevoir des procédures qui tiennent compte de la pluralité des intérêts tout en préservant l’intégrité et l’applicabilité des procédures.
Arbitrage augmenté par l’IA et intelligence stratégique
L’intelligence artificielle transformera la pratique de l’arbitrage, non seulement par l’automatisation, mais aussi par l’intelligence stratégique. L’analyse prédictive, le traitement du langage naturel et les systèmes d’aide à la décision amélioreront la gestion des dossiers, l’analyse des précédents et la modélisation des risques. Ces outils permettront aux parties de simuler des résultats, d’optimiser leurs stratégies et d’anticiper le comportement des arbitres.
Cependant, l’intégration de l’IA soulève des préoccupations stratégiques concernant les biais, l’opacité et le contrôle. Les institutions doivent mettre en place des cadres de gouvernance qui garantissent la responsabilité algorithmique, la supervision humaine et le respect de l’éthique. L’arbitrage deviendra un espace hybride où le jugement humain et l’intelligence artificielle co-produisent des résultats juridiques, ce qui nécessitera de nouvelles normes de transparence et d’équité procédurale.
Réforme des traités et réaffirmation de la souveraineté
Les États réaffirment leur souveraineté par le biais d’une réforme des traités, en intégrant des clauses qui protègent l’autonomie réglementaire dans des domaines tels que la politique climatique, la santé publique et la stabilité financière. Ces réformes reflètent un rééquilibrage stratégique du droit des investissements, où l’équilibre entre la protection des investisseurs et le pouvoir discrétionnaire des États est en cours de renégociation.
Les arbitres seront confrontés à des défis d’interprétation complexes lorsqu’ils appliqueront le libellé évolutif des traités à des contextes politiques dynamiques. Les litiges porteront de plus en plus sur des questions de proportionnalité, de nécessité et de légitimité, ce qui exigera des arbitres qu’ils s’engagent dans des raisonnements stratégiques plus larges. La prolifération des traités et des cadres régionaux qui se chevauchent compliquera encore davantage l’analyse juridictionnelle et la cohérence normative.
Façonner l’arbitre de demain
Une formation stratégique pour un paysage juridique complexe
L’arbitre de 2035 devra être plus qu’un simple technicien juridique : il devra être un interprète stratégique de la complexité mondiale. Les litiges impliquant de plus en plus souvent des juridictions qui se chevauchent, des technologies sensibles et des normes contestées, les arbitres devront disposer d’une formation multidisciplinaire alliant rigueur juridique, conscience géopolitique, connaissances technologiques et discernement éthique.
La question du genre est devenue un enjeu central dans l’arbitrage, non seulement en termes de représentation, mais aussi en tant que préoccupation structurelle qui façonne la légitimité, l’équité et la crédibilité institutionnelle. En 2023, les principales institutions d’arbitrage ont signalé une augmentation modeste mais significative du nombre de femmes arbitres nommées, comme le taux de 29,7 % de confirmations et de nominations de femmes par la CCI. Toutefois, des disparités persistent, en particulier lorsque les parties ou les co-arbitres contrôlent les nominations, où les femmes sont encore nettement moins souvent sélectionnées2. Ce déséquilibre a donné lieu à des initiatives telles que l’Equal Representation in Arbitration Pledge (engagement en faveur d’une représentation équitable dans l’arbitrage) et à la création de groupes de travail interinstitutionnels visant à promouvoir des pratiques de nomination plus inclusives.
Au-delà de la représentation, le genre influence également les normes procédurales et les attentes substantielles. Il est démontré que la diversité des tribunaux enrichit les délibérations et renforce la confiance des parties prenantes, en particulier dans les litiges portant sur les droits de l’homme, les obligations ESG ou les impacts sur les communautés. De plus, la communauté arbitrale reconnaît de plus en plus que la diversité des genres ne peut se réduire à des mesures binaires : elle recoupe des questions plus larges d’identité, d’accès et d’équité. À mesure que l’arbitrage évolue, le genre n’est plus une préoccupation périphérique, mais un prisme à travers lequel la légitimité, la réactivité et la justice mondiale sont redéfinies.
Les dimensions clés de la formation future des arbitres comprennent
Maîtrise de la géopolitique et de la réglementation : Les arbitres doivent comprendre les intérêts stratégiques des États et des entreprises, la dynamique des systèmes juridiques régionaux et les implications de la réforme des traités. La formation doit inclure des modules sur la gouvernance mondiale, les cadres de souveraineté et l’économie politique du règlement des différends.
Compétences technologiques et gouvernance des données : L’IA, les biotechnologies et les infrastructures numériques étant au cœur des litiges futurs, les arbitres doivent maîtriser des concepts techniques tels que les biais algorithmiques, la cybersécurité et la propriété intellectuelle dans les domaines émergents. Cela nécessite une collaboration avec des ingénieurs, des scientifiques spécialisés dans les données et des éthiciens pour la conception des programmes de formation.
Analyse de l’impact environnemental et social : Avec la multiplication des litiges liés au climat et à l’ESG, les arbitres doivent être en mesure d’évaluer les analyses environnementales, les rapports d’impact sur les communautés et les indicateurs de durabilité. Cela nécessite l’intégration du droit de l’environnement, des sciences sociales et des méthodologies d’engagement des parties prenantes dans la formation des arbitres.
Innovation procédurale et conception adaptative : L’arbitre du futur doit être capable d’adapter les procédures à des litiges complexes, multipartites et multinormatifs. Cela implique de se familiariser avec les mécanismes hybrides, les audiences numériques et les outils participatifs tels que les amicus curiae et les consultations publiques.
Réflexivité éthique, normative et en matière de genre : au-delà de la neutralité, les arbitres doivent cultiver une réflexivité éthique, c’est-à-dire une conscience de la manière dont les décisions juridiques façonnent les biens publics, la légitimité institutionnelle et les normes mondiales. Cela implique de reconnaître l’influence des dynamiques de genre sur l’accès à la justice, l’équité procédurale et la perception de l’autorité arbitrale. La formation doit inclure des études de cas sur les préjugés sexistes, les disparités de représentation et les implications normatives d’un jugement inclusif dans les espaces de gouvernance contestés.
Communication stratégique et leadership institutionnel : les arbitres joueront de plus en plus un rôle institutionnel, façonnant l’évolution des normes et des pratiques arbitrales. Un leadership inclusif en matière de genre est essentiel à cette transformation. Les arbitres doivent être équipés pour s’engager dans une communication stratégique qui reflète les perspectives diverses des parties prenantes, promouvoir une représentation équitable dans les nominations et contribuer à des réformes institutionnelles qui intègrent la parité entre les sexes et la conscience intersectionnelle dans l’écosystème arbitral.
Pour y parvenir, les institutions arbitrales, les universités et les réseaux professionnels doivent collaborer à la conception de programmes d’études avancés, d’environnements d’apprentissage basés sur la simulation et de programmes de certification interdisciplinaires. La formation des arbitres doit évoluer d’un enseignement juridique statique vers une éducation stratégique dynamique, les préparant à naviguer dans les litiges volatils, pluriels et à enjeux élevés de la décennie à venir.
Conclusion : vers un arbitrage stratégique dans un monde complexe
D’ici 2035, l’arbitrage international servira non seulement d’instrument stratégique de gouvernance mondiale, mais reflétera également l’évolution des exigences en matière d’inclusivité, de transformation technologique et de pluralisme régional. La diversité des genres sera au cœur de sa légitimité, dépassant la représentation symbolique pour tendre vers l’équité structurelle dans les nominations, le leadership et la conception des procédures. Des initiatives telles que l’Equal Representation in Arbitration Pledge (Engagement en faveur d’une représentation équitable dans l’arbitrage) ont jeté les bases, mais des réformes plus profondes sont nécessaires pour remédier aux disparités persistantes entre les arbitres nommés par les parties et pour garantir une inclusion intersectionnelle entre les sexes, les ethnies et les parcours professionnels. Un écosystème arbitral véritablement représentatif renforcera la confiance, enrichira les délibérations et s’alignera sur les impératifs plus larges de la justice mondiale.
La transformation technologique redéfinira à la fois le fond et la procédure de l’arbitrage. La gestion des dossiers assistée par l’IA, les protocoles de preuve numérique et les audiences virtuelles deviendront la norme, exigeant de nouvelles compétences en matière d’analyse de données, d’éthique et de responsabilité algorithmique. L’arbitrage sera également de plus en plus sollicité pour régler des litiges liés aux technologies émergentes, telles que la blockchain, l’informatique quantique et la gouvernance des plateformes, ce qui exigera des tribunaux qu’ils interprètent des questions juridiques nouvelles avec une vision interdisciplinaire. Les institutions doivent investir dans des infrastructures adaptées aux technologies et dans des règles de procédure adaptatives afin de rester crédibles dans ce domaine en rapide évolution.

PM Legal News | Flash – Octobre 2025
Transformation durable du système financier colombien : nouvelle réglementation sur la gestion intégrale des risques environnementaux, sociaux et climatiques
La circulaire externe 015 de 2025, publiée le 3 octobre par la Superintendance financière de Colombie, marque une étape importante dans l’évolution du système financier national vers la durabilité. Cette réglementation obligatoire pour les entités surveillées (à quelques exceptions près) établit un cadre juridique solide pour intégrer les risques environnementaux, sociaux et climatiques (RASC) dans les systèmes de gestion financière.
Quels changements cette circulaire apporte-t-elle ?
- Nouveau chapitre XXXIII dans la circulaire comptable et financière de base (CBCF).
- Modifications des paragraphes 3.1.4 et 3.2 du chapitre IV de la circulaire juridique de base (CBJ).
- Obligation d’intégrer les risques RASC dans les politiques internes, les opérations de crédit, les investissements et les assurances.
- Plans de formation, rapports périodiques et documentation technique sur la catégorisation et le suivi des risques.
Types de risques identifiés
- Risques physiques : événements climatiques extrêmes (ouragans, sécheresses, inondations).
- Risques de transition : changements réglementaires, technologiques et économiques vers une économie à faible émission de carbone.
Indicateurs de référence volontaires (annexe 1)
Bien qu’ils ne soient pas obligatoires, ces indicateurs permettent de mesurer les vulnérabilités et d’orienter les décisions stratégiques :
- IERF : Indice d’exposition aux risques physiques
- IRTE : Indice de risque de transition énergétique
- IERS : Indice d’exposition au risque social
- PFCI / IFCC : Participation aux programmes internationaux de financement climatique et au financement combiné pour le climat
Délais de mise en œuvre
- Plan d’action : dans les 6 premiers mois.
- Mise en œuvre totale : 18 mois maximum.
- Application anticipée : autorisée et reconnue publiquement par la Superintendance.
Pourquoi cette réglementation est-elle essentielle ?
Ignorer ces directives peut exposer les entités à des risques réputationnels, financiers et opérationnels. En revanche, leur respect :
- Renforce la confiance institutionnelle.
- Protège les communautés vulnérables.
- Positionne la Colombie comme leader régional en matière de finance durable.
Votre entité est-elle prête ?
C’est le moment de revoir vos politiques, de former vos équipes et de concevoir des stratégies conformes à la nouvelle réglementation. Si vous avez besoin de conseils juridiques spécialisés pour mettre en œuvre cette réglementation, notre équipe est prête à vous accompagner.

Défis juridiques et stratégies pour la protection de la biodiversité en Colombie : vers une transition économique verte
Par Daniel Peña Valenzuela, associé chez Peña Mancero Abogados
I. Introduction
Le cadre constitutionnel colombien établit la protection de la biodiversité comme un devoir fondamental de l’État et un droit de tous les citoyens (derecho fundamental y colectivo). En tant que l’un des pays les plus riches en biodiversité au monde, la Colombie est confrontée à un défi juridique et politique complexe : comment concilier sa richesse écologique avec les impératifs de la croissance économique, du commerce international et du développement rural. L’expansion de la frontière agricole, l’émergence des marchés bioéconomiques et l’essor de l’écotourisme en tant qu’outil de financement de la conservation exigent une réponse juridique cohérente.
Cet article examine les mécanismes réglementaires, institutionnels et fiscaux nécessaires pour transformer la biodiversité, qui est actuellement un atout vulnérable, en un pilier stratégique de la transition économique verte de la Colombie.
II. Frontière agricole et instruments juridiques pour une utilisation durable des terres
La récente mise à jour de la frontière agricole colombienne révèle un total de 42,9 millions d’hectares, un chiffre qui souligne à la fois l’ampleur du potentiel productif et l’urgence d’une intervention juridique. Cette frontière recèle de vastes zones de sols dégradés ou sous-utilisés qui, s’ils étaient reconvertis dans le cadre juridique approprié, pourraient accueillir des systèmes agroforestiers, des modèles sylvopastoraux et des cultures pérennes telles que le cacao, le caoutchouc, l’huile de palme certifiée et le bois à cycle long. Ces transitions ne sont pas de simples innovations agronomiques ; il s’agit de transformations juridiques qui nécessitent des règlements de zonage, des licences environnementales et des instruments d’aménagement du territoire conformes à la loi 99 de 1993 et aux mandats du Système national de l’environnement (SINA).
La justification juridique de la promotion de ces transitions repose sur leur capacité à réduire la déforestation, à augmenter la productivité par hectare et à permettre l’accès aux marchés internationaux qui exigent une durabilité vérifiable. Le règlement de l’Union européenne sur la déforestation (EUDR), qui s’appliquera aux grandes entreprises colombiennes en 2025 et aux petites et moyennes entreprises colombiennes en 2026, impose des obligations strictes de diligence raisonnable aux importateurs de produits de base tels que l’huile de palme, le soja, le cacao et le bois. Les producteurs colombiens doivent donc adopter des systèmes de certification et des protocoles de traçabilité légalement reconnus afin de rester compétitifs et conformes.
III. Systèmes de certification : pertinence juridique, complexité opérationnelle et intégration au marché
Les systèmes de certification sont de plus en plus considérés non pas comme des normes volontaires, mais comme des instruments juridiques d’accès au marché et de conformité environnementale. La Colombie doit institutionnaliser et étendre plusieurs systèmes de certification, chacun ayant des exigences juridiques, techniques et opérationnelles distinctes. La Table ronde sur l’huile de palme durable (RSPO), par exemple, exige des producteurs qu’ils fassent preuve de transparence, de responsabilité environnementale et de respect des droits des communautés. Cela implique une vérification juridique du régime foncier, le respect des protocoles de consentement libre, préalable et éclairé (FPIC) et l’alignement de l’ sur les lois nationales en matière de foresterie et d’environnement. Dans des régions telles que Meta et Chocó, où l’expansion de la culture du palmier à huile empiète sur les territoires ethniques et les zones post-conflit, la certification RSPO doit s’accompagner de garanties juridiques solides afin d’éviter l’expropriation des terres et la dégradation écologique.
De même, la certification Bonsucro pour la production de canne à sucre met l’accent sur la productivité, les droits du travail et l’impact environnemental. En Colombie, sa mise en œuvre doit tenir compte des complexités liées au respect du droit du travail, aux permis d’utilisation de l’eau et à la réglementation des pesticides sous la supervision de l’Institut colombien de l’agriculture (ICA) et de l’Institut national de surveillance des aliments et des médicaments (INVIMA). La Table ronde sur le soja responsable (RTRS), qui exige une production sans OGM, zéro déforestation et une responsabilité sociale, pose des défis juridiques supplémentaires, notamment en ce qui concerne l’harmonisation de ses normes avec le cadre réglementaire colombien sur les organismes génétiquement modifiés et les évaluations d’impact environnemental.
VI. Traçabilité et gouvernance des données : établir un cadre juridique pour la durabilité
La traçabilité est le pilier juridique de la certification. Sans systèmes robustes permettant de géoréférencer les parcelles, de surveiller la production et de vérifier la conformité, les certifications perdent leur crédibilité et leur force exécutoire. La Colombie doit légiférer sur un système national de traçabilité qui inclut la cartographie géospatiale obligatoire des parcelles de production, reliée aux registres cadastraux et environnementaux. Ce système doit garantir l’interopérabilité entre les ensembles de données publiques, tels que ceux gérés par l’IGAC, l’ICA et l’ANLA, et les données du secteur privé, tout en respectant les principes de protection des données consacrés par la loi 1581 de 2012.
Les protocoles de vérification doivent être normalisés et reconnus juridiquement, y compris les audits par des tiers, les technologies de télédétection et les systèmes basés sur la blockchain. Ces mécanismes doivent être réglementés par la Superintendencia de Industria y Comercio afin de garantir la transparence, la responsabilité et la confiance des consommateurs. Il est essentiel que le cadre juridique prévoie des incitations et une assistance technique pour les petits et moyens producteurs, qui risquent d’être exclus des marchés formels en raison des coûts élevés et de la complexité de la mise en conformité. Cela comprend des systèmes de certification subventionnés, des procédures de déclaration simplifiées et des protections juridiques contre les pratiques commerciales discriminatoires.
V. Bioéconomie : instruments juridiques pour l’innovation, l’équité et l’accès au marché
La richesse biologique de la Colombie offre une occasion unique de développer une bioéconomie centrée sur les ingrédients naturels, les bio-intrants, les biomatériaux et les composés bioactifs pour la santé et les cosmétiques. Pour libérer ce potentiel, l’État doit adopter et appliquer des instruments juridiques qui favorisent la protection de la propriété intellectuelle, l’accès et le partage des avantages (APA) et les partenariats public-privé. Le cadre juridique doit garantir que les brevets et les droits sur les variétés végétales pour les composés bioactifs sont protégés en vertu de la décision andine 486 et de la législation nationale sur la propriété intellectuelle, tout en garantissant que les communautés bénéficient de la commercialisation des ressources génétiques conformément, entre autres, au protocole de Nagoya.
Les partenariats public-privé doivent être structurés juridiquement de manière à faciliter le co-investissement dans la recherche et le développement, le transfert de technologie et l’incubation d’entreprises bioéconomiques. Cela nécessite l’articulation de plans sectoriels, de documents CONPES (documents de politique publique) et d’incitations fiscales à l’innovation. La rationalisation de la réglementation est également essentielle : les procédures d’enregistrement des intrants biologiques et des produits naturels auprès de l’INVIMA et de l’ICA doivent être simplifiées afin de réduire les obstacles à l’entrée sur le marché.
VI. Écotourisme et conservation : conception et application de la réglementation
L’écotourisme, lorsqu’il est structuré juridiquement, peut servir de mécanisme financier pour la conservation de la biodiversité et le développement inclusif. Les composantes juridiques doivent inclure des limites applicables en matière de capacité d’accueil par destination, des plans de gestion environnementale contraignants et des normes pour la conception des infrastructures, la gestion des déchets et l’utilisation de l’eau.
Les chaînes de valeur locales doivent être encouragées juridiquement par des avantages fiscaux, des programmes de formation et un accès préférentiel aux zones protégées. Des mécanismes de surveillance et d’application doivent être mis en place pour empêcher les pratiques touristiques prédatrices qui dégradent les écosystèmes et la réputation. Les zones protégées, les territoires autochtones et les réserves privées doivent être régis par des normes juridiques claires qui équilibrent l’accès et la conservation. Le tourisme nature, s’il est structuré juridiquement, peut devenir un mécanisme d’autofinancement pour la protection des écosystèmes et un générateur d’emplois dignes.
VII. Mécanismes de financement : vers un fonds vert légalement obligatoire
Le financement de la biodiversité nécessite une conception juridique sobre. La Colombie peut réserver une partie des recettes supplémentaires provenant de l’exploitation minière légale et des taxes prévues pour la transition énergétique à un fonds vert national. Ce fonds devrait être légalement mandaté pour soutenir les paiements pour services environnementaux (PSE), les subventions pour la certification et la traçabilité, la restauration des bassins versants et le contrôle territorial contre l’illégalité. Les coûts de certification et de traçabilité doivent être cofinancés par des instruments juridiques qui favorisent l’équité et l’inclusion. Les investissements dans les infrastructures écologiques doivent être réglementés par la loi 99 de 1993 et la politique nationale de l’eau, tandis que le contrôle territorial doit être soutenu par des cadres juridiques pour les procureurs environnementaux, les gardes forestiers et les observateurs communautaires.
VIII. Conclusion : légiférer sur la transition verte
Afin de consolider la transition de la Colombie vers une économie fondée sur la biodiversité, le pays doit adopter une feuille de route juridique structurée qui articule la réforme réglementaire, le renforcement institutionnel et l’innovation fiscale. Cette feuille de route doit s’appuyer sur des mandats constitutionnels, des obligations internationales et des priorités nationales en matière de développement, et doit être mise en œuvre par le biais d’actions coordonnées au niveau législatif, exécutif et territorial.
La Colombie doit promulguer une loi nationale sur la transition vers une utilisation durable des terres, établissant des critères juridiques pour la reconversion des sols dégradés en systèmes agroforestiers, sylvopastoraux et de cultures pérennes. Cette loi devrait définir les conditions d’éligibilité, les garanties environnementales et les incitations pour les producteurs qui adoptent des pratiques zéro déforestation. Elle doit également intégrer des mécanismes de reconnaissance juridique des systèmes de certification et leur intégration dans les protocoles environnementaux d’octroi de licences et de commerce.
Le pays doit légiférer sur la création d’une infrastructure nationale de certification et de traçabilité. Cela inclut la reconnaissance juridique de normes internationales telles que RSPO, Bonsucro et RTRS, et la création d’un registre public des producteurs certifiés. Une loi complémentaire devrait rendre obligatoire la création d’un système national de traçabilité, avec des dispositions relatives à la cartographie géospatiale, à l’interopérabilité des données et à la vérification par des tiers, afin de garantir le respect du règlement de l’Union européenne sur la déforestation et d’autres exigences commerciales émergentes.
La Colombie doit adopter un cadre juridique pour la promotion de la bioéconomie. Cela comprend des lois sur la protection de la propriété intellectuelle pour les composés bioactifs, des mécanismes d’accès et de partage des avantages alignés sur le protocole de Nagoya, et des incitations fiscales pour la recherche, le développement et le transfert d’ s technologiques. Le cadre devrait également inclure des voies réglementaires simplifiées pour l’enregistrement et la commercialisation des intrants biologiques et des produits naturels, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.
Le pays doit réformer ses lois sur le tourisme et la conservation afin de permettre à l’écotourisme de devenir un mécanisme légalement structuré de financement de la conservation. Cela implique de mettre à jour la législation environnementale et touristique afin d’y inclure des limites applicables en matière de capacité d’accueil des visiteurs, des plans de gestion environnementale obligatoires et des normes relatives aux infrastructures et à la prestation de services. Les instruments juridiques doivent également promouvoir les entreprises touristiques communautaires et garantir un accès équitable aux zones protégées.
La Colombie doit légiférer sur la création d’un fonds vert national, financé par une partie légalement réservée des recettes provenant des taxes légales sur l’exploitation minière et la transition énergétique. Ce fonds devrait être régi par une loi spécifique qui définit ses objectifs, sa structure de gouvernance et les dépenses éligibles, y compris les paiements pour les services environnementaux, les subventions pour la certification et la traçabilité, la restauration des bassins versants et le contrôle territorial contre la criminalité environnementale.
La feuille de route doit inclure des dispositions transversales pour la coordination institutionnelle, le renforcement des capacités et la participation publique. Cela comprend la création de comités intersectoriels, des mandats légaux en matière de transparence et de responsabilité, et des mécanismes de consultation avec les communautés autochtones, afro-descendantes et rurales.
En résumé, la biodiversité de la Colombie doit être protégée non seulement par des déclarations politiques, mais aussi par des instruments juridiques exécutoires qui concilient l’intégrité écologique et les opportunités économiques. La transition vers une économie verte nécessite un cadre juridique solide qui transforme la biodiversité en une source de productivité, d’équité et de résilience. Le moment est venu de légiférer pour assurer cet avenir.

COLOMBIE: jurisprudence récente concernant les contrats d’agence commerciale et les contrats de distribution
Gabriela MANCERO-BUCHELI | COLOMBIE
Dans l’une des affaires les plus récentes concernant les contrats d’agence commerciale en Colombie, la Cour supérieure de Bogotá a précisé que le risque économique n’exclut pas en soi l’existence d’une agence commerciale. Toutefois, il s’agit d’un facteur déterminant lorsqu’il s’accompagne d’une indépendance opérationnelle, d’une liberté de fixation des prix et de l’absence d’instructions de la part du contractant.
Cet article traite de la décision n° 11001 3103 045 2021 00461 01 rendue par la Cour supérieure de Bogotá le 12 mai 20251.1
Contexte de l’affaire
MTBASE S.A.S. a intenté une action en justice contre SAP Colombia S.A.S., affirmant qu’il existait un contrat d’agence commerciale entre les deux sociétés, d’une durée ininterrompue, continue et indéterminée, du 2 juin 1993 au 31 décembre 2019.
Le plaignant a fait valoir que les éléments essentiels d’un contrat d’agence étaient présents, affirmant qu’il avait été chargé de la promotion et du positionnement commercial du produit, en plus d’exercer des fonctions techniques liées à la commercialisation de licences de logiciels.
Jugement de première instance
La 45e chambre civile du circuit de Bogotá a donné raison au plaignant, estimant que l’objet principal des contrats était la distribution de logiciels destinés à la revente, ce qui pouvait inclure des services d’assistance et des services complémentaires offerts directement par le plaignant. La Cour a également noté qu’aucune clause contractuelle n’imposait au demandeur des obligations d’agence lui imposant d’agir au nom du défendeur dans le but de positionner ou de développer l’activité sur le marché des logiciels, et qu’il n’existait aucune preuve que le demandeur se soit engagé dans des activités de développement du marché au profit du défendeur.
Appel
Le demandeur a fait appel du jugement de première instance, arguant que, puisque le contrat d’agence commerciale concernait des œuvres ou des créations artistiques (logiciels), la transaction juridique aurait dû être enregistrée auprès de l’Office national du droit d’auteur, preuve que le demandeur n’a jamais opéré en tant qu’entité juridique distincte du défendeur. En outre, l’assistance technique fournie par le demandeur aux clients était dispensée à la suite d’une formation dispensée par le défendeur, ce qui suggère qu’« il n’y avait aucune distinction entre le demandeur et le défendeur du point de vue des clients et du marché ».
Analyse de la Cour supérieure de Bogota
La Cour supérieure de Bogota a analysé les preuves et a conclu que, contrairement à ce que suggère l’appelant, le dossier montre que le comportement contractuel des parties, qui a duré 26 ans, est conforme à la nature et au contenu d’un contrat de distribution.
La Cour a conclu qu’il était établi que le demandeur assumait les risques inhérents à l’achat en vue de la revente, compromettant ainsi à la fois la promotion de l’activité d’autrui et la perception d’une rémunération, éléments intrinsèques à un contrat d’agence commerciale. Cela était attesté par les factures de vente montrant que les clients avaient acquis les licences logicielles directement auprès du demandeur. En conséquence, le défendeur n’a pas versé de commissions à l’appelant ; sa rémunération provenait plutôt de la différence entre le prix d’achat des licences logicielles et le prix de revente plus élevé facturé aux consommateurs.
La décision stipulait:
«Ce n’est pas sans raison que la jurisprudence a souligné que « bien que les éléments essentiels de l’agence aient été identifiés comme étant la permanence ou la stabilité de la mission, l’indépendance de l’agent et les fonctions d’intermédiaire visant à acquérir, conserver, développer ou récupérer des clients pour le mandant, une grande partie de la doctrine s’accorde à dire que c’est la promotion de la conclusion d’affaires — où le mandant assume le risque économique — qui constitue le contenu typique distinguant le contrat d’agence des autres arrangements contractuels, car les autres éléments peuvent également être présents dans différents types d’accords (…). » Le fait d’agir au nom et pour le compte d’un tiers a été souligné par la jurisprudence de cette chambre comme étant la caractéristique la plus déterminante pour établir si le contrat liant les parties constitue un contrat d’agence commerciale. (CSJ, arrêt du 30 septembre 2015, dossier 2004 00027) ».
La Cour a également souligné qu’il n’existe aucun document écrit ni aucune preuve à l’appui pour étayer les prétentions du demandeur. Au contraire, il existe de nombreuses preuves documentaires, notamment des factures d’achat, qui corroborent la conclusion du juge de première instance selon laquelle le demandeur a principalement agi en achetant des produits à SAP COLOMBIA S.A.S. pour les revendre à des tiers.
En outre, comme indiqué précédemment, les preuves montrent que MTBASE S.A.S. est restée silencieuse pendant plus de deux décennies, acceptant ainsi implicitement la prestation de services caractéristiques d’un contrat de distribution de licences de logiciels, plutôt que ceux d’une agence commerciale. Ce comportement est contraire aux principes juridiques fondamentaux, notamment l’interdiction d’agir en contradiction avec son propre comportement antérieur (venire contra factum proprium).
Conclusion
La Cour a conclu qu’il n’existait aucun contrat d’agence commerciale entre les parties, car le demandeur agissait en tant que distributeur indépendant, ne recevait aucune rémunération du défendeur puisque son bénéfice provenait non pas d’une commission, mais de la marge entre les prix d’achat et de revente, et supportait tous les risques commerciaux. De plus, le demandeur achetait les licences directement au défendeur et les revendaient sous son propre nom, sans aucun mandat de représentation ou de direction de la part du défendeur.
La décision a clairement souligné que le risque économique n’est pas accessoire mais un élément essentiel, car sa présence continue exclut l’existence d’une relation d’agence.
Gabriela Mancero-Bucheli, experte nationale IDI pour l’agence et la distribution en Colombie
Andrea Sánchez Gallardo
- Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, et l’affaire est actuellement en attente d’une décision de la Cour suprême de justice.
Domaines de compétence

Contentieux

Arbitrage National et International

Contrats Internationaux

Droit Corporatif et Droit des Sociétés

Fusions et Acquisitions

Droit Commercial
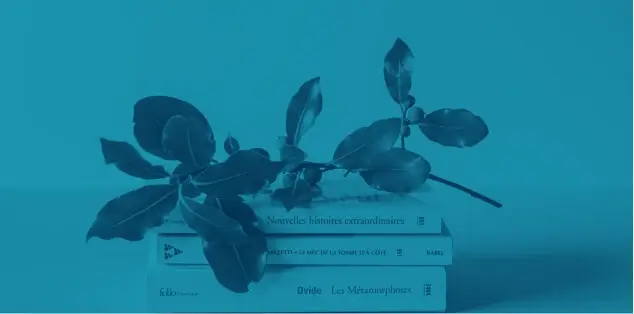
Propriété Intellectuelle

Droit de la Concurrence

Coopération Internationale et Entités à but non Lucratif

Investissement Étranger

Droit Migratoire et Droit des Étrangers

Droit Fiscal

Marchés de Change

Droit Minier

Droit de L’énergie

Droit du Numérique et Télécommunications

Protection des Données Personnelles et de la Vie Privée

Protection du Consommateur

Droit du Travail et de la Sécurité Sociale

Droit Immobilier et de L’urbanisme
Remerciements








Adhésions









